Papangu - Holoceno
Chronique CD album (44:08)

- Style
Zeuhl metal progressif - Label(s)
Autoproduction - Date de sortie
25 juin 2021 - Lieu d'enregistrement Par Ruy José au Estúdio Mutuca, João Pessoa
- écouter via bandcamp
Lâchons le name dropping de bon aloi tout de go : ils se réclament de groupes comme Mastodon, King Crimson et Magma. Ils viennent du pays de la samba, des strings et du foutcheubol, chantent dans leur langue, servent un metal progressif, technique, décomplexé, d'une inventivité et d'une liberté folles. Il s'agit là de leur 1e méfait, et assurément un des albums qui érigeront 2021 au rang d’excellent millésime. Msieudames : Papangu.
Avant d’entamer le voyage que propose Holoceno, qu’on effectuera dans le détail, étape après étape, il convient de s’arrêter sur certaines des références affichées par le groupe, notamment le zeuhl, ce genre musical inventé par les créateurs du kobaïen, complètement perchés, emmenés par la bande à Christian Vander. Entre jazz, rock prog et psyché, le zeuhl draine tout un tas de groupes (dont certains connus par les amateurs d'indus : Art Zoyd) dont le chef de file reste le légendaire Magma. Avec le zeuhl, on tutoie l’infini par le truchement de lignes de chants intersidérales, de structures alambiquées et d’idées créatrices qui provoquent un véritable feu d’artifice dans le cerveau de l‘auditeur. Le tout résumé en un seul qualificatif : cosmique.
Ceci dit, qu’on ne s’attende pas à du zeuhl pur et dur, Papangu ne cherche pas la surenchère technique, ne se perd pas sur moult chemins de traverses, surtout au sein d’un même titre (quoique, on y va y revenir), mais sur l’ensemble de ce 1e opus, varie plutôt les paysages que le trip auquel il nous convie cache, à chaque détour, chaque virage, chaque carrefour. Du reste, si sa musique fait penser à ses modèles, le groupe se montre suffisamment inspiré pour prouver qu’il a bien digéré ses influences pour imposer sa touche personnelle. Une totale maîtrise qui force le respect. On pense donc au zeuhl de ses aînés, mais l’héritage de la rage de Mastodon, de son sens de la mélodie tombée du ciel et des ruptures d’une fluidité qui relève de l’évidence se manifeste subrepticement sur nombre des titres de l’album.
Nous le disions plus haut, si Papangu accorde une place idoine à chaque instrument sur chaque titre, chacun livrant une partition au service de la chanson, il évite le piège de la démonstration. Sans jamais céder à la facilité, et en osant la moindre extravagance. Paradoxe dompté au terme de 7 années de travail méticuleux. Mais là où l’album s’avère génial, c’est dans l’agencement de sa track list. Chaque titre réserve son lot de surprises, aucun ne laisse l’auditeur sur un acquis, chacun révèle une nouvelle facette de la palette musicale du groupe. Nous pourrions filer la métaphore culinaire, affirmer que chaque chanson rassasie l’auditeur et exacerbe dans une même dynamique son appétit, celui-ci se trouvant à la fête dès le titre suivant. Nous lui préférerons le champ sémantique du voyage. Au milieu d’un paysage pluriel, riche de 1001 détails s’imposant et se dérobant en même temps, qui dévoile de nouvelles richesses au fur et à mesure que la route se déploie à l’horizon.
Adonc, dès l’ouverture, impossible de savoir à quel genre rattacher le groupe. Bien souvent, le chant offre des indices, des pistes, des repères. Ici, que nenni. Le périple débute sur un instrumental. Trois minutes sans préambule, qui prennent d’emblée à la gorge et explosent au visage et dans la tête sans forcer mais avec une assurance qui confine à l’outrecuidance. Construit autour des parties de batteries, assurées par Torstein Lofthus (Elephant9 et surtout Shining), qui imposent le rythme et les changements de rythmes, « Ave Bala » se montre à la fois puissant, nerveux, armé de riffs incisifs, mais sans jamais négliger un sens de la mélodie insensé. Et surtout, dans les enchaînements de ses parties, ne laisse aucun répit à l’auditeur. Celui-ci se trouve littéralement happé par le moteur lancé à plein régime.
Forcément, le second titre apporte de nouveaux éléments. Ah tiens, du chant clair, en brésilien, avec ces intonations chaudes, fatalement tropicales, des mélodies qui ondulent langoureusement au gré du groove de la basse et des soubresauts de la batterie, invitant presque à entamer une danse sensuelle sur une plage de sable fin, sous la douce lueur de la une. Là encore, c’est la batterie qui insuffle les envolées viriles à l’ensemble, avant qu’un clavier n’entame un solo enfiévré en diable. On est déjà loin de l’entame de l’opus, et pourtant, on est bel et bien à la bonne place : installé confortablement, mais solidement, dans un véhicule en furie dévorant l’asphalte.
Nous avons donc affaire à un groupe de metal progressif ? Ce serait faire fausse route que de s’en tenir à ce constat, sur la foi de ces 2 premiers morceaux, car voilà-t-y pas que dès le début du 3e titre se fait entendre du growl. Rapidement rejoint par les lignes de chant clair, certes, mais le mal est fait, le poison inoculé, le nouveau pan du parcours dévoilé. « Sao Francisco » monte d’un cran dans la puissance et la rage ambiante, mais sans se départir de son sens de la mélodie. Si on s’en tient à notre sémantique du voyage, c’est comme si, le poignard entre les dents, les yeux révulsés et le pied au plancher, nous dévalions une pente sans se soucier de la fin de cette course folle.
Avec ces 3 échantillons, on commence à se sentir en confiance : du prog, des relents de death, du zeuhl exotique, un parfait cocktail de fureur et de mélodie, technique et pourtant suffisamment avenant pour se montrer accessible. C’est compter sans « Bacia das Almas » qui, après la descente en ligne droite, nous emporte dans les hauteurs d’une corniche sinueuse à flanc de falaise sous laquelle paresse un décor de paradis perdu. Sans perdre en vitesse, l’album gagne en sensualité. Ce morceau de bravoure, avec son gimmick entêtant à la guitare et le groove soutenu de la paire basse/batterie, flirte avec l’idée qu’on peut se faire d’une bande son idéale d’un porno chic de qualité. Sensualité renforcée par le solo de clavier, dispensé par le minimoog voyager (tiens tiens, un clavier qui se dit voyageur) de Uana Barreto qui donne envie d’effectuer des cascades sur le museau rugissant d’une décapotable avant d’embrasser à pleine bouche le ou la passagère du véhicule.
Après la virée dans les hauteurs torrides, Papangu nous entraîne dans la fange du sludge. Lent, lourd, inquiétant, mais toujours en fusion, « Terra Arrasada » ne reste cependant pas longtemps sur ces territoires, et c’est là qu’on revient sur la nuance à apporter sur l’apparente absence de surenchère dans la complexité de sa musique. Car de la longue intro clairement sludgesque, le titre bascule sur une ambiance au rythme plus chaloupé, très zeuhlesque, pour le coup, avec des vocalises presque incantatoires, donnant à l’ensemble des allures de grand messe apocalyptique. Si le périple pouvait nous faire littéralement quitter le sol et décoller à la rencontre des mystères de l’univers, rien ne nous empêche d’y songer.
A partir de là, Papangu se montre plus complexe dans la structure de ses compositions. « Lobisomem » démarre avec la même rage que le titre d’ouverture, cette fois appuyé par un chant râpeux, porté par des riffs tour à tour incisifs et pachydermiques. On se dit que le groupe mélange alors les ingrédients utilisés jusqu’alors, sous nos yeux se mêlent lignes pentues et sinueuses, courbes escarpées et bas-côtés riches d’une végétation dense et secrète. Quand soudain, le clavier et le saxophone de, respectivement, Luis Souto Maior et Benjamin Mekki WiderØe (que les fans de Seven Impale connaissent) viennent contredire cette impression, en apportant un nouveau souffle, en dessinant un tableau inédit jusque là. Du reste, la présence bouillante du saxophone offre un reflet complémentaire au titre final qui donne son nom à l’album. « Holoceno » répond à la sensualité sale, quasiment sexuelle, de « Lobisomem », par une forme d’extase enfin atteinte, un peu comme si, au terme d’une virée à travers une foisonnante succession de sensations mêlées, il était temps de se jeter dans le vide, ou de quitter définitivement le plancher, pour, dans une explosion de fluides et d’atomes, embrasser l’infini. Cette destination finale n’aurait absolument aucun sens sans la totalité des escales qui parsèment ce voyage fantastique. Vous vous dites que vous êtes arrivé, à la fin de l’album. En réalité, vous avez tout bonnement disparu. Au sens propre comme au figuré, la musique de Papangu vous a emporté.


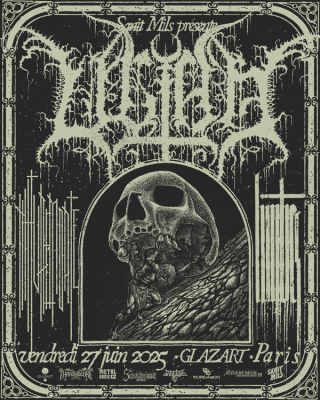



0 COMMENTAIRE
AJOUTER UN COMMENTAIRE